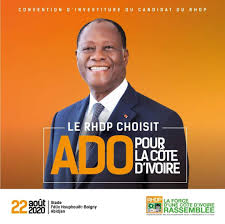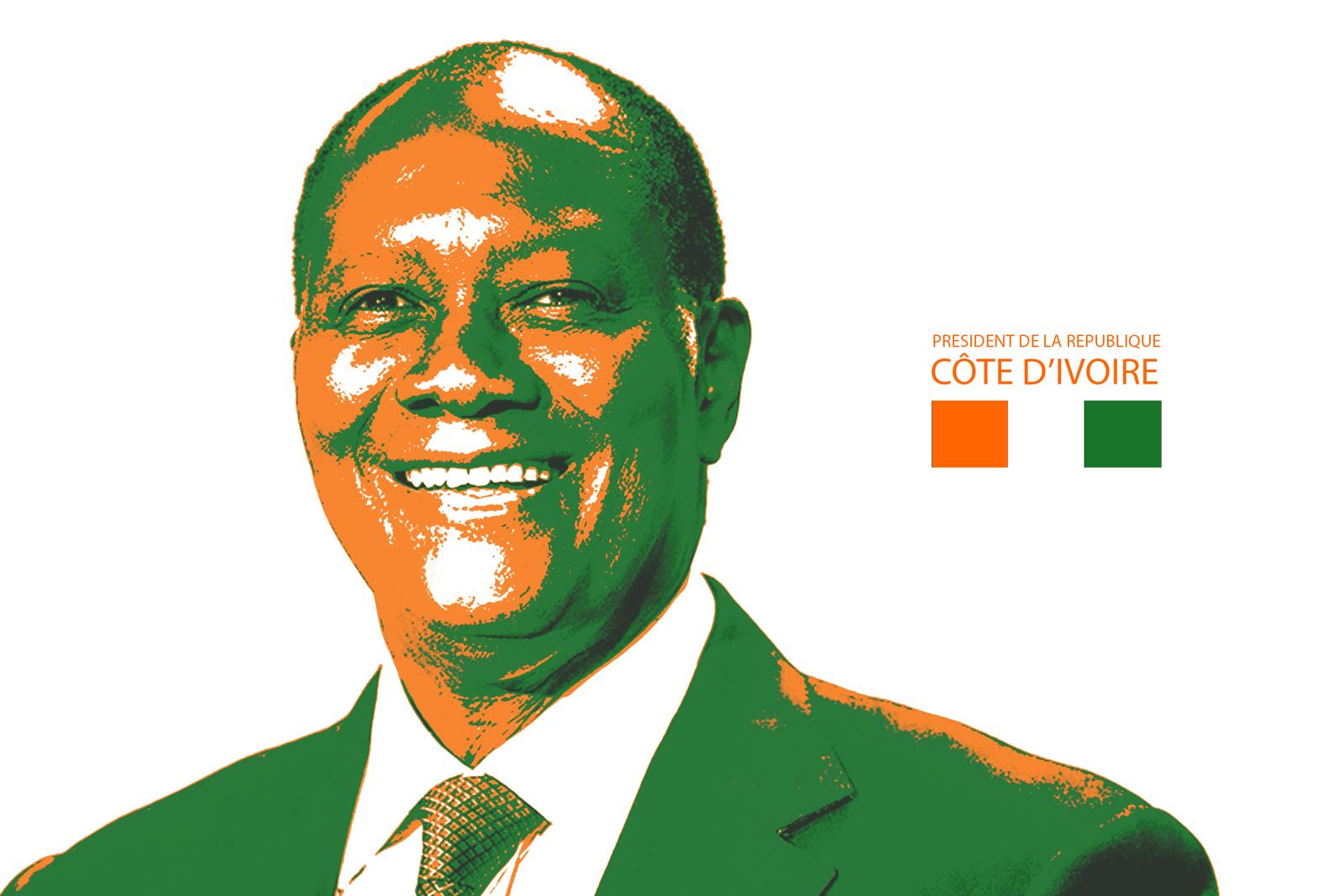Aperçu sur l’industrie textile en Côte d’Ivoire.
La chaîne de valeur
La filière textile ivoirienne se compose de six maillons principaux (APEX-CI, 2003) :
Les producteurs de coton graine ;
Les unités d’égrenage ;
Les unités de filature et de tissage ;
Les unités d’impression ;
Les unités de confection industrielle et de bonneterie ;
Les couturiers et habilleurs.
Certaines entreprises se retrouvent à la fois dans plusieurs maillons.
Evolution de l’industrie textile
Après avoir atteint un niveau de transformation d’environ 20% dans les années 1990, le tissu industriel textile s’est dégradé d’année en année pour atteindre aujourd’hui un taux de transformation d’à peine 2% de la production totale de coton fibre. A ce niveau il faut dire que la filière a connu moult restructurations notamment en 1992 (effective en 1993) et en 1998. Les entreprises ont essayé tant bien que mal de s’adapter aux différentes situations. Certaines ont disparu dans le temps, d’autres ont subi des mutations. D’autres encore par contre ont fusionné pour créer de nouvelles entités.
Les difficultés rencontrées
Durant le processus de développement économique du pays, l’industrie textile a rencontré de nombreuses difficultés qui ont conduit à sa restructuration à maintes reprises. Au nombre de celles-ci, l’on note les problèmes de trésorerie et le manque d’appui financier des banques. Ainsi donc plusieurs d’entre elles vont tourner à moins de 50% de leur capacité voire autour de 25%. De ce fait, les coûts fixes unitaires sont élevés et il y a une absence d’économies d’échelle.
De plus, la crise militaro-politique de 2002 est venue avec son cortège de malheurs. Le grand Nord, zone de production de coton dont la capitale est Korhogo était assiégé par la rébellion armée. La production cotonnière tournait au ralenti. Pis, les usines de textiles dans cette zone en ont souffert dans la mesure où elles étaient fermées ou pillées. La crise a favorisé la porosité de nos frontières terrestres facilitant ainsi les actions de contrebande.
Enfin, le coup fatal provient de la contrefaçon. En effet, à la faveur de la crise de 2002, le pouvoir d’achat des Ivoiriens a considérablement baissé. Ainsi les pagnes ivoiriens (Uniwax et Fancy) seront contrefaits et introduits frauduleusement sur le marché ivoirien. C’est le cas en particulier des Chinois, qui en plus de leur marque Hitarget déjà vendue bon marché et prisée par les consommateurs, contrefont le pagne Wax dont les motifs ont du succès auprès des femmes pour le revendre et surtout à moitié prix environ de l’original.
Les conséquences
Les conséquences inéluctables sont de prime abord la fermeture de nombreuses usines. Environ 80% des entreprises du secteur ont disparu. Cela a conduit à la perte d’environ 10.000 emplois (douanes.ci). À cet effet, c’est de nombreuses familles dans la misère et un nombre considérable d’élèves et étudiants qui sortiront précocement du système éducatif par faute de moyens des parents.
Au niveau étatique c’est une baisse de recettes fiscales. Les entreprises fermées ne paieront plus d’impôts et taxes. Il en est de même pour les marchandises de contrebande qui entrent sur le marché par des voies détournées qui échappent aux taxes douanières. Les pots-de-vin liés à cette fraude organisée prendront d’autres chemins que les caisses de l’Etat.
Les efforts pour y remédier
La lutte contre la contrefaçon
En 2009, un protocole d’accord a été signé entre Uniwax et la direction des douanes pour la lutte contre la contrefaçon (douanes.ci). En effet, avec un chiffre d’affaire de 30 milliards en 2003 l’on note une chute du chiffre d’affaire d’Uniwax à 16 milliards en 2007. Cet accord était donc bienvenu. Uniwax a également développé de nouvelles techniques marketing en accélérant la production de nouveaux motifs (environ 60 par mois) pour garder une longueur d’avance sur les imitateurs et en innovant au niveau technologique par l’introduction de nouvelles techniques de gravures et d’impressions. On peut voir que son chiffre d’affaire est passé à 50 milliards environ en 2013 (Banque mondiale, 2015).
Au niveau de l’Etat, une loi sur la contrefaçon a été votée par le Parlement (Loi n° 2013-865 du 23 décembre 2013). Elle vise à renforcer la protection des droits de propriété aux frontières dans les opérations d’importation et d’exportation et à mettre en place un dispositif de lutte contre les importations de produits contrefaits. (Jean Claude Brou, 2014).
Autres actions d’appui au secteur textile
Cinq axes principaux ont été adoptés dans la stratégie de relance de la filière textile:
Restructurer et développer les entreprises textiles;
Restaurer la compétitivité de la filière (création d’une Zone Franche Textile à Bouaké, accroître la productivité de la main d’œuvre par la formation) ;
Créer un cadre de concertation permanente entre les acteurs de la filière;
Promouvoir la filière textile ivoirienne;
Engager la lutte contre la fraude et la contrefaçon.
En définitive, nous retenons que le secteur textile se porte mal. Il est plus que jamais impérieux de penser à comment relever de façon efficace les difficultés de la filière textile ivoirienne en ce sens qu'elle est intensive en travail et donc une solution partielle au problème d'employabilité.
La côte d’Ivoire ne détiendrait-elle pas l’arme de son autodestruction dans la mesure où elle exporte près de 98% de sa production cotonnière ? Comment peut-elle s’inspirer de la Corée qui à un moment donné de son histoire s’est appuyée sur son secteur textile ?
Industrie textile : La Côte d’Ivoire à l’assaut du marché américain
En 2015, Abidjan a exporté pour environ 1 milliard de dollars de marchandises vers les Etats-Unis dont seulement 5,86% ont bénéficié des facilités de l’AGOA (entrée en franchise de douanes). Une situation qui est symptomatique de l’absence d’une stratégie nationale AGOA expliquée par le fait que le pays ait été retiré de la liste des pays bénéficiaires de cette initiative entre 2005 et octobre 2011, selon Gérard Amangoua, directeur adjoint de l’APEXCI, l’agence dédiée à la promotion des exportations ivoiriennes.
Aussi, le pays envisage-t-il, pour mieux tirer parti de ce mécanisme, de diversifier son offre dans le secteur textile et de l’habillement, une filière identifiée comme prioritaire et à forte valeur ajoutée.
« Il faut bâtir de véritables unités industrielles capables de produire mille à 5 mille pièces, voire plus, par jour pour intéresser les acheteurs américains » a fait remarquer Emmanuel Odonkor du Trade Hub (organisme membre de l’USAID) qui a exposé sur le modèle ghanéen en pleine expansion. Pour se faire la stratégie nationale doit être transversale, selon Paul Millogo, consultant à la BAD, la Banque africaine de développement.
Le fait est qu’à l’exception d’une entreprise comme Uniwax, la filière ivoirienne se résume pour l’essentiel à une série de sociétés en difficulté ou en restructuration (FT Gonfreville, Utexi ou encore Cotivo) et à de petits ateliers de confections essentiellement de type artisanal.
« Il faut construire une expertise technique, soutenir la formation technique de la main d’œuvre, subventionner les frais d’eau et d’électricité, accompagner les acteurs dans l’implémentation des normes sociales et environnementales américaines, mettre en place des infrastructures adaptées etc. » a conseillé Emmanuel Odonkor. Des mesures appliquées avec succès par le Ghana ou encore l’Ethiopie et le Kenya et qui sont de nature à attirer les investisseurs asiatiques et mauriciens « qui cherchent à délocaliser leurs usines en Afrique » indique-t-il.
Mais pour installer durablement l’industrialisation de la filière, il faut aller plus loin, depuis la recherche scientifique afin d’identifier des semences à même de produire du coton de qualité, jusqu’à la mise en place de toute une chaîne logistique efficace capable par exemple de convoyer quotidiennement les commandes vers le sol américain, a-t-il insisté.
Une industrie locale qui se cherche …
Pour la côte d’Ivoire, les acteurs ont déploré les contraintes et le peu d’intérêts des politiques. « Il existe une expertise locale formée en Europe qui a fait tourner des industries textiles aujourd’hui à l’arrêt comme COTIVO » a fait remarquer Guépié Pierre, qui revendique 35 ans de service dans l’industrie textile. « J’ai reçu à COTIVO des stagiaires du Ghana venus se former et qui sont ensuite retournés pour développer leurs industries … » a-t-il souligné.
« Les regards, selon lui, sont tournés vers les investisseurs étrangers à qui l’on propose toutes sortes de facilités, alors qu’en accordant les mêmes faveurs aux usines locales en difficulté et aux unités locales existantes, il sera possible de relever et de booster le secteur ».
Une position défendue Frédéric Tano, patron de O’Sey Collection, l’un des rares à exporter des vêtements vers les Etats-Unis. « Par manque de financement, nous achetons des machines d’occasion pour nos petites unités, qui sont du coup moins productives et consomment plus d’électricité de sorte que nous ne sommes pas assez compétitifs. En outre avec la fermeture de COTIVO, trouver du tissus en quantité et en qualité avec les commerçants locaux est une autre source de difficulté ». Une situation qui, ont expliqué les experts, fait qu’il est 2,5 fois plus cher de produire du textile et vêtements en Côte d’Ivoire qu’au Maroc, et trois plus cher qu’en Tunisie.
L’atelier qui s’achève ce mercredi devrait donc permettre de faire le point de l’ensemble de ces contraintes afin de redonner un nouveau souffle à une filière qui manifestement dispose de ressorts pour rebondir.
Pour rappel, les Etats-Unis ont reconduit en 2015 l’initiative AGOA pour encore une dizaine d’année, jusqu’en 2025.
Deux unités textiles prévues pour 2020 et 2021 en Côte d'Ivoire.
Alors que la plupart des unités de transformation du pays sont en sous-activités, peu compétitives et témoignent de faibles rendements, le représentant du ministre croit en une filière cotonnière de deuxième et de troisième transformation, source d'emplois durables, de revenus au profit des acteurs de la filière coton. Il déclare vouloir industrialiser la filière.
Cette volonté s'affirme également sur fond de lutte contre la fraude de textiles venant de Chine. « Le coton transformé en Chine sous forme de pagnes et de vêtements est remis en fraude dans nos pays africains, puisque la plupart des produits fabriqués en Chine ne viennent en fraude que sur nos économies, en particulier celle de la Côte d'Ivoire » souligne le président de l’Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire (UGECI) et PDG d'Uniwax, Jean-Louis Menudier.
20% du coton ivoirien traité sur place
L’occasion pour lui d’affirmer la volonté de deux de ses partenaires de construire en Côte d’Ivoire « deux grosses unités de textile, le premier en 2020 et le second probablement en 2021 » souligne l’APA.
Rappelons que les unités textiles FTG, Cotivo, Utexi traitent 20 % de la production de coton fibre du pays (25 000 tonnes) et permettent d’approvisionner les unités de production d’imprimés tels que Uniwax, Texicodi et Ivtex.
Le gouvernement a adopté une politique industrielle de relance de la filière textile depuis 2012 avec la réhabilitation de l’existant, la promotion de l’investissement et la création d’une zone franche. Des mesures qui ont boosté l’activité de la filière et a augmenté de 17 % le nombre de producteurs de coton (88 407 à 103 336 producteurs) et de 24 % les surfaces semées. Des modifications qui ont augmenté la production de coton de 13 % (fixé à 468 953 t) en 2018/19 et de passer du 4e au 3e rang des producteurs de coton africain.